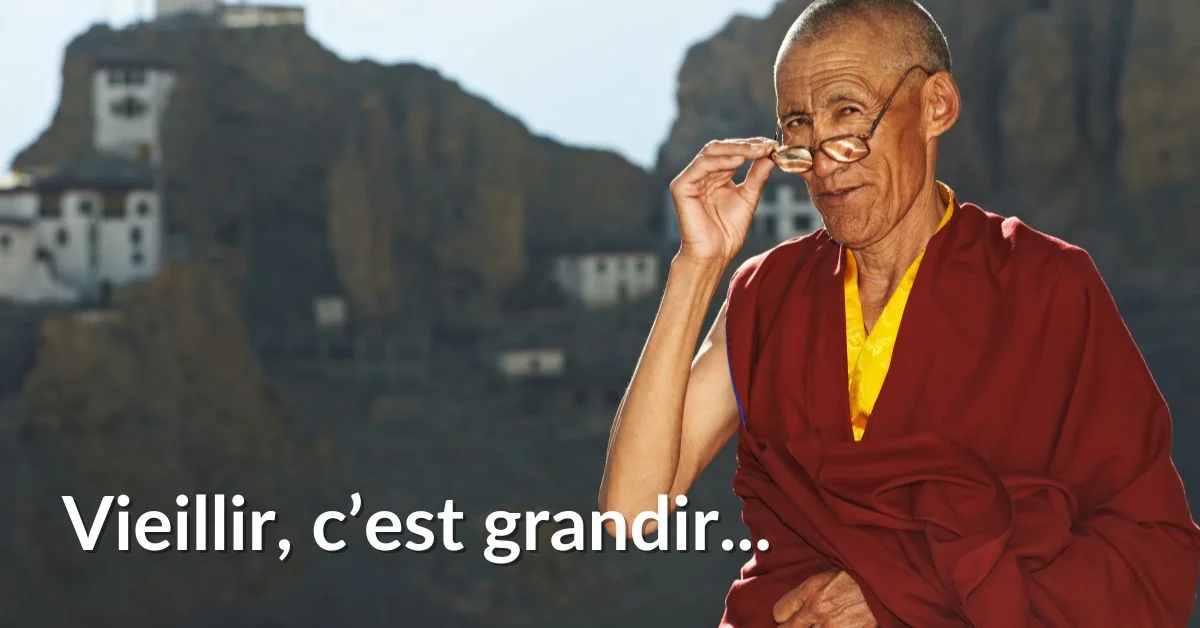Quand philosophie et neurosciences osent regarder les cheveux blancs sans trembler
Introduction – Vieillir… et pourtant se sentir toujours le même
Vieillir, c’est voir son miroir devenir cruel sans jamais oser l’insulter à voix haute (de peur qu’il riposte).
C’est croiser des adolescents et se dire avec une pointe d’effroi :ur
« Ce n’est pas moi qui étais aussi stupide à leur âge, n’est-ce pas ? »
Et pourtant, malgré les articulations grinçantes
et les notices de médicaments qu’on lit avec plus d’intérêt que les romans de Houellebecq,
une sensation persiste : celle d’être resté le même au fond.
Mais alors, soyons sérieux deux minutes (et pas plus) :
cette impression d’un « moi » inoxydable,
c’est une ruse du cerveau ou une vérité de l’âme ?
Est-ce que ce fichu sentiment de continuité n’est qu’une illusion bien ficelée,
ou bien avons-nous en nous un petit noyau dur qui résiste à tout, y compris à l’homéopathie ?
Les philosophes modernes et les neuroscientifiques – ces gens très intelligents qui arrivent à se prendre au sérieux même quand ils disent « hypothalamus » avec gravité – ont planché sur la question.
I. Les philosophes d’aujourd’hui : vieillir, c’est se révéler (enfin presque)
Il fut un temps où vieillir signifiait s’approcher doucement de Dieu,
à défaut d’être encore capable de courir vers lui.
Aujourd’hui, certains philosophes – qui ont visiblement bien vécu et mangé bio –
nous expliquent que vieillir, ce n’est pas décliner, c’est devenir.
Charles Pépin, par exemple, nous rassure :
nous ne devenons pas des versions moins performantes de nous-mêmes,
mais des versions mieux filtrées.
Il appelle ça devenir soi.
On pourrait aussi dire :
Se dépouiller de tout ce qui n’est pas soi,
comme un oignon qui, une fois pelé, laisse apparaître… les larmes.
Cynthia Fleury, elle, évoque la « sagesse du soin » qui viendrait avec l’âge.
Comprenez : avec le temps,
on s’ennuie moins de sa propre personne
et on commence à remarquer que les autres existent.
C’est beau, non ?
On devient plus doux, plus lucide.
On cesse de courir et on commence à regarder.
Pas les séries Netflix, non : le monde.
Michel Serres, lui, avait cette manière joyeuse et décalée de penser le temps.
Pour lui, vieillir, c’est élargir sa perception, habiter plusieurs temps à la fois.
Il disait :
« Je me sens de plus en plus jeune. J’ai juste davantage d’années. »
Dans ses textes, il défendait l’idée que le corps change, certes,
mais que l’esprit, lui, s’ouvre à d’autres formes d’intelligence :
celle du lien, de la mémoire, de la lenteur.
Vieillir n’était pas une perte, mais un déploiement.
Luc Ferry, quant à lui, voit dans la vieillesse une occasion de réinventer le lien aux autres.
Pour lui, vieillir, c’est apprendre à aimer autrement :
moins dans la conquête, plus dans la profondeur.
Il insiste sur la valeur de la transmission et sur cette capacité nouvelle à donner du sens à ce qu’on lègue.
C’est aussi, selon lui, un âge où l’on fait la paix avec ses angoisses,
en apprenant à vivre pleinement malgré la finitude.
« Le propre de la sagesse, ce n’est pas d’être jeune ou vieux,
c’est d’aimer la vie malgré sa fragilité. »
Bref, pour ces penseurs raffinés,
vieillir, ce n’est pas s’effacer, c’est se révéler.
Ou, pour parler comme un poète sous anxiolytiques :
C’est passer du paraître à l’être,
du tumulte à l’essentiel,
du selfie à la solitude féconde.
II. Les neurosciences : un cerveau qui change, un moi qui insiste
Côté sciences, les nouvelles sont presque bonnes.
Le cerveau vieillit, oui,
mais pas comme un melon qu’on oublie dans le frigo.
Plutôt comme un grand vin :
il perd un peu en fraîcheur, mais gagne en profondeur
(sauf si on abuse du vin, auquel cas c’est le foie qui parle en dernier).
1. De nouveaux neurones à tout âge – La promesse de Boldrini
Pendant longtemps, on nous a répété que les neurones ne se renouvelaient pas.
Une fois perdus, envolés…
Mais en 2018, la chercheuse Maura Boldrini bouleverse cette croyance :
même à 70 ou 80 ans, le cerveau continue à produire de nouveaux neurones,
en particulier dans l’hippocampe — cette région qui gouverne la mémoire et les émotions.
Et mieux encore :
chez les personnes âgées sans troubles cognitifs, cette neurogenèse reste active,
surtout si elles mènent une vie socialement connectée, curieuse, physiquement active.
Le cerveau peut rester jeune, tant qu’on lui donne des raisons de continuer à vivre.
2. Vivre longtemps, penser longtemps – Leçons du Baltimore Longitudinal Study of Aging
Depuis plus de 60 ans, l’étude de Baltimore suit des milliers de personnes âgées.
On y découvre que l’on peut vieillir sans forcément décliner cognitivement.
Les secrets de ces esprits vifs ?
Une vie affective riche,
une activité intellectuelle constante,
et surtout une capacité à donner du sens à leurs expériences.
Certes, la rapidité de traitement diminue,
mais on gagne autre chose :
de la profondeur, de la nuance, de la sagesse.
Le cerveau vieilli devient moins un outil de performance
qu’un organe de résonance.
Antonio Damasio, qu’on ne présente plus sauf aux gens qui lisent Voici,
nous rappelle que le sentiment d’être soi est ancré dans le corps.
Ce n’est pas qu’une affaire de souvenirs bien classés dans une armoire mentale :
c’est aussi une odeur, un frisson, un silence vécu un soir d’été.
Ces marqueurs somatiques —
c’est comme ça qu’il appelle nos miettes de mémoire sensorielle —
nous tiennent ensemble comme des boutons sur une chemise trop serrée.
Et puis il y a Thomas Metzinger, philosophe des sciences, qui nous fait un peu peur :
pour lui, le moi n’existe pas.
Enfin, il existe, mais seulement comme une sorte de logiciel généré par notre cerveau,
pour qu’on ne panique pas trop.
Autrement dit, nous serions une fiction utile,
un roman dont le héros croit qu’il est réel.
Ce qui, soyons honnêtes, est plus rassurant que d’être un personnage de série télé.
Mais tout cela converge vers une chose :
même si notre cerveau change,
il maintient une impression de cohérence,
comme un écrivain qui corrige les incohérences de son récit au fil des chapitres.
On appelle ça : rester soi.
Et, cerise sur le neurone, les études montrent que
plus on vieillit, plus on devient zen.
Moins d’angoisses, plus de recul,
et une capacité à relativiser qui ferait passer le Dalaï-Lama pour un influenceur survolté.
III. Vivre, c’est évoluer… sans se trahir (même quand on oublie où sont ses lunettes)
À force de croiser philosophie et neurosciences, une idée émerge (sans gluten) :
Vieillir, c’est changer, certes, mais sans perdre le fil.
Un peu comme ces films de Woody Allen où tout change, sauf les névroses.
Le moi n’est pas une statue, mais un fleuve.
Il change, il creuse, il déborde parfois.
Mais il suit toujours une direction.
Vivre, c’est accepter que le cours bouge,
que le paysage évolue,
mais que la rivière reste la même.
Vieillir, alors,
c’est se transformer sans renier.
C’est oser dire au monde :
« Je ne suis plus celui d’hier,
mais je suis encore moi. »
Et tant pis si ce « moi » a mal au dos
et des lunettes progressives.
Conclusion – Une sagesse moderne du temps (et de l’autodérision)
Dans une époque obsédée par le jeunisme (ce mot sonne déjà comme une insulte),
il est bon de rappeler que le temps ne détruit pas tout, il révèle aussi.
Il révèle qu’on peut être plus profond à 60 ans qu’à 20.
Qu’on peut aimer mieux, parler moins,
et s’émerveiller de plus en plus de moins en moins.
Vieillir, ce n’est pas mourir à petit feu,
c’est vivre plus doucement,
mais plus vrai.
Finalement, vivre pleinement,
ce n’est pas fuir les années,
mais marcher avec elles, bras dessus, bras dessous,
comme avec une vieille amie qui radote un peu
mais connaît tous nos secrets.
Un exercice introspectif (sans ordonnance requise)
Prenez cinq minutes.
Pas pour méditer, non.
Écrivez une lettre à la version plus jeune de vous-même.
Celui qui croyait qu’à 40 ans, on serait riche, célèbre et musclé.
Que lui diriez-vous ?
Qu’a-t-il compris ?
Et qu’a-t-il mal jugé ?
Car peut-être qu’au fond,
le secret du vieillissement,
ce n’est pas de rester jeune,
mais d’apprendre à rire doucement en regardant son passé.