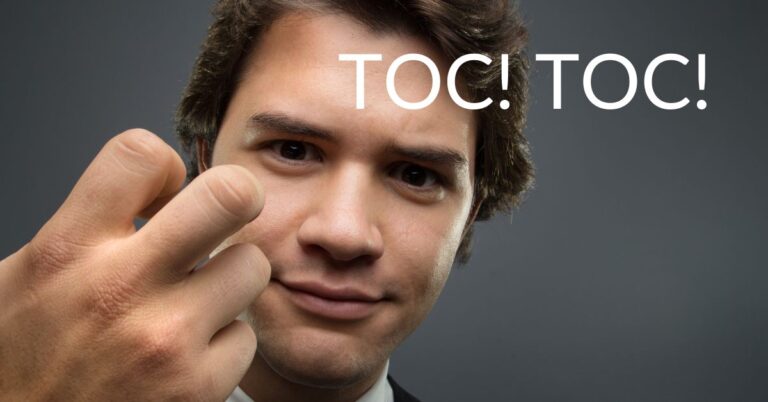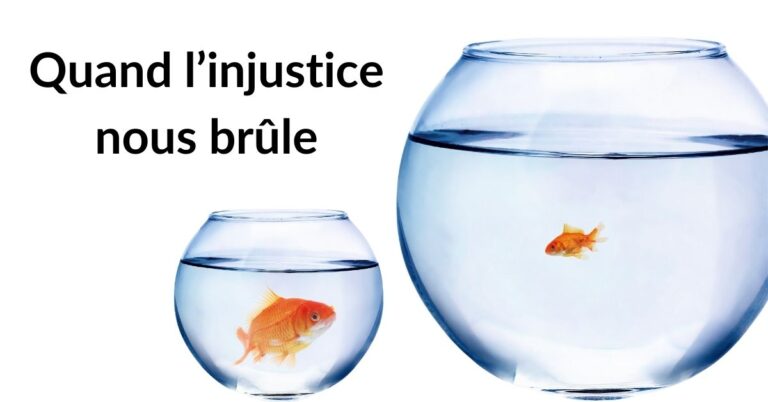Ou comment s’échapper du réel sans être interné.
Préambule inutile mais parfaitement justifié
L’imagination. Ce mot flou comme un nuage qui change de forme quand on le regarde trop longtemps. Ça sent le rêve éveillé, la cabane au fond du cerveau et l’enfant intérieur qui n’a jamais rangé sa chambre.
On nous dit : « Laissez parler votre imaginaire… », mais on oublie de préciser que parfois, l’imaginaire crie, fait des fautes d’orthographe et se prend pour une licorne sociologue.
Et pourtant, ce joyeux bazar mental n’est pas qu’un terrain de jeu pour poètes barbus et enfants nourris au jus de pomme bio. C’est un mécanisme vital. Une sorte de soupape existentielle qui évite à nos neurones de frire dans la banalité.
Les neurosciences montrent que le cerveau consacre une énergie considérable à des activités non directement liées au réel : anticiper, rêver, reconstruire, imaginer. On appelle ça le Default Mode Network. Autrement dit, quand vous croyez ne rien faire, votre cerveau prépare une évasion par le toit.
Et la philosophie, dans ses heures les plus lumineuses, nous souffle que l’imagination est la condition même de la liberté. Si je ne peux pas imaginer autre chose que ce qui est, alors je suis prisonnier du présent. Donc, rêver, c’est préparer sa propre évasion sans violer la loi.
1. Imaginer, c’est mentir. Mais gentiment.
Prenez Claudine. 72 ans, retraitée, veuve, et très méfiante envers les vendeurs de bonheur en pilule. Elle vit seule dans un appartement où même le frigo soupire.
Mais quand elle ferme les yeux, elle se retrouve sur une plage mythique qu’elle n’a jamais vue, dans un corps qu’elle n’a plus, avec un homme qu’elle n’a jamais connu mais qui lui parle comme dans un vieux film en noir et blanc. Et elle rigole en me disant :
« Docteur, dans ma tête, je suis canon et je sens la noix de coco. Dans la vraie vie, je sens plutôt le chou, mais ça, je garde pour moi. »
Ce que Claudine fait là, ce n’est pas de la folie douce. C’est de l’hygiène mentale. Elle reprogramme temporairement son expérience émotionnelle. Les chercheurs appellent ça la simulation mentale positive : imaginer des scènes agréables stimule les mêmes circuits que les vivre réellement, y compris ceux liés à la dopamine et à l’ocytocine.
La philosophie morale nous rappelle aussi que le faux peut guérir là où le vrai échoue. Si un imaginaire fictif redonne du courage, est-ce moins vrai que le réel qui déprime ? Claudine, en rêvant de samba, fait mieux que résister : elle invente une trêve.
2. L’imaginaire, ce muscle flasque qu’on peut quand même essayer de remuscler
Jean-Claude, 54 ans, marié, deux ados, une lombalgie et une passion inavouée pour les BD des années 80, m’a dit un jour :
« Quand j’en ai marre, je m’imagine que je suis un ours. Je dors six mois. Je me réveille, tout le monde m’a oublié, et j’ai enfin la paix. »
Son épouse trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça brillant. Parce que Jean-Claude ne fuit pas le réel, il le reformule avec humour et tendresse. Et ça, c’est de l’intelligence émotionnelle en mouvement.
Les scientifiques nous disent que l’imagination, comme les biceps ou la capacité à faire des gratins, s’entretient. Plus on l’utilise, plus elle devient souple, rapide, inventive. Des chercheurs de l’université de Yale ont montré que les personnes habituées à créer des images mentales de réconfort résistent mieux au stress chronique.
Et puis, soyons honnêtes : dans un monde où le réel ressemble parfois à une réunion de copropriété qui s’éternise, il est sain de se fabriquer une forêt intérieure.
Jean-Claude n’est pas un fuyard. C’est un stratège. Et un ours plein de sagesse.
3. Imaginer, c’est résister. (Avec panache, tant qu’à faire.)
René, 78 ans, veuf, ancien boulanger, continue de parler chaque soir à son épouse disparue. Mais avec une pointe d’ironie :
« Elle continue à me dire que j’ai oublié les œufs. Même morte, elle ne me laisse pas tranquille. C’est rassurant. »
Ce que René fait là, ce n’est pas une lubie. C’est un acte de résistance affective. Il refuse que l’amour se dissolve dans le silence. Il invente un lien. Il fait vivre une voix. Il transforme l’absence en présence facétieuse.
Et du côté des sciences, on observe que les scénarios imaginaires dans lesquels les défunts continuent à dialoguer avec nous activent les zones de la mémoire affective et réduisent les risques de dépression sévère.
Imaginer que quelqu’un continue de nous répondre, même en pensée, c’est rester vivant du côté de l’amour.
Et la philosophie existentielle nous souffle que résister, ce n’est pas forcément manifester ou s’indigner. Parfois, résister, c’est faire parler les morts dans sa cuisine sans devenir fou. Et rire en lavant les casseroles.
4. La liberté de l’esprit, c’est de pouvoir être un écureuil. Même à 82 ans.
Yvonne, 82 ans, ne veut ni antidépresseurs ni conseils de vie. Mais elle écrit tous les matins une lettre à Rodolphe, un homme imaginaire né en 1923, amateur de jazz et de ponctuation impeccable.
« Il me demande chaque matin si j’ai bien dormi. Et surtout, il ne parle jamais politique. »
Ce petit rituel, qui ferait sourire un observateur pressé, est en réalité un chef-d’œuvre de préservation mentale. Yvonne stimule sa mémoire, entretient ses facultés langagières, et surtout, elle construit un espace où elle reste sujet de sa vie.
La psychologie cognitive l’appelle « narration symbolique autonome ». En gros : se raconter quelque chose qu’on choisit, plutôt que de subir ce qu’on vit. Et les effets sont mesurables : baisse du stress, maintien de la motivation, augmentation du sentiment d’identité.
La liberté ne se mesure pas en kilomètres parcourus. Elle se niche parfois dans une lettre inventée, un dialogue fictif, un amour imaginaire qui protège du vide.
Conclusion – Le réel est surestimé
L’imagination n’est pas un gadget. C’est une technologie interne de résilience. Elle n’annule pas le réel : elle lui apporte un coussin, une lumière douce, une issue de secours.
Ce monde nous impose des bulletins météo de l’âme : « Tempête en vous ce matin, avec éclaircies improbables en soirée. »
Mais l’imagination, elle, fait surgir un jardin sous la pluie, une musique au fond du silence, un élan dans les jours plats.
Et ici, en Charente, entre les vignes et les silences ruraux, on a tout ce qu’il faut pour laisser rêver une endive philosophe ou un écureuil qui lit des poèmes.
Exercice inutile mais follement important
Fermez les yeux. Imaginez que vous êtes une endive.
Mais pas une endive triste de supermarché. Une endive flamboyante, charnue, militante.
Demandez-vous :
Qu’ai-je envie de cuisiner avec ma vie aujourd’hui ?
Et si vous hésitez entre une tarte, un poème ou une lettre à Rodolphe… c’est que vous êtes encore debout.