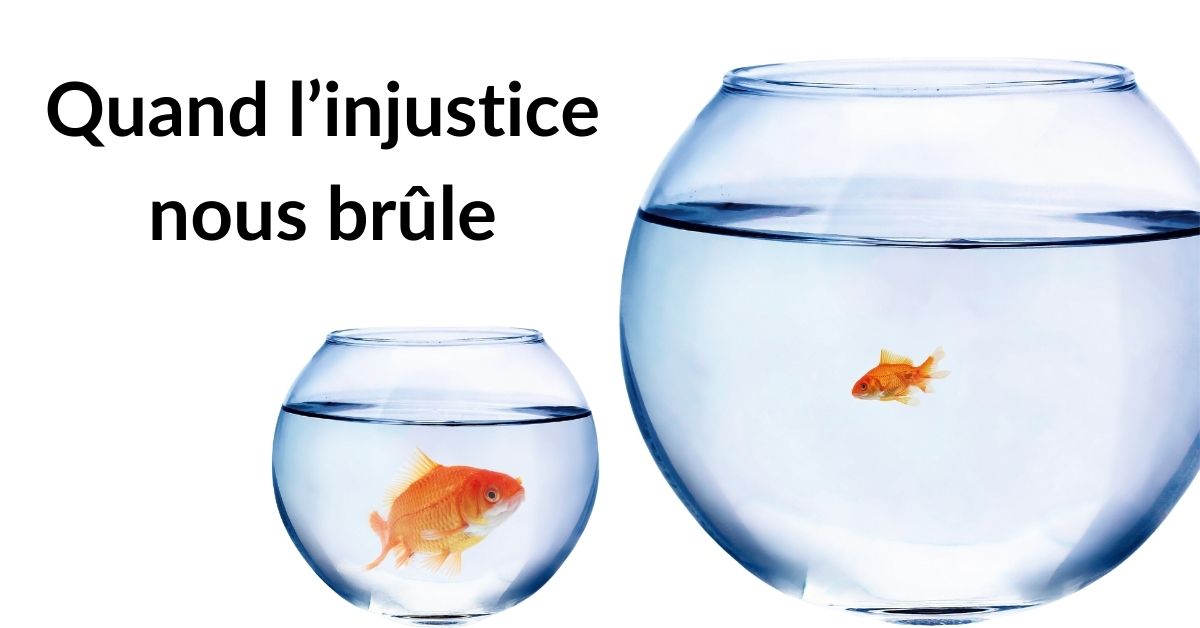Il existe des douleurs visibles, bruyantes, spectaculaires. Et puis il y a l’injustice, plus sournoise, plus intime ! Elle ne se contente pas de nous faire mal : elle sape nos repères, installe le doute, murmure que notre place n’est pas respectée. Elle se vit un peu partout : dans le couple, dans les yeux des enfants, dans la cour de récréation, dans les bureaux, au cœur des amitiés, au sein des familles, et jusque dans le mystère brutal de la vie elle-même.
Elle laisse toujours derrière elle cette impression glaciale : « Je ne compte pas autant que les autres. » Et dire qu’on nous avait promis l’égalité… En réalité, certains héritent du tapis rouge, d’autres d’un paillasson élimé.
Dans le couple
Les injustices de couple ne font pas la une des journaux. Elles se nichent souvent dans le silence, le soir, dans les regards qui ne se croisent plus. Elles ne sont pas toujours faites de cris ou de trahisons éclatantes. Parfois, elles s’installent doucement : l’un qui se lève la nuit pour les enfants, l’autre qui ronfle comme une locomotive ; l’un qui gère les factures, l’autre qui oublie même de payer l’électricité. À force, la balance finit toujours par pencher.
C’est une fatigue sourde, une solitude déguisée en vie à deux. Et parfois, la trahison vient donner le coup de grâce : adultère, mensonge, projet secret. Là, l’injustice est totale : on découvre qu’on a joué une pièce entière alors que l’autre avait quitté la scène depuis longtemps. Et quand la séparation arrive, le juge vient achever l’œuvre : pensions impayées, responsabilités mal partagées, décisions arbitraires. On sort de l’histoire vidé, en se demandant si « pour le meilleur et pour le pire » ne voulait pas dire : L’un pour payer l’addition, l’autre pour savourer le banquet.
Comment faire face ?
En osant mettre des mots : « Je me sens seul(e) à porter », « Je me sens invisible. »
En demandant du soutien, sans honte.
Et quand rien ne change, en reconnaissant qu’il est parfois plus juste de partir que de s’éteindre.
Car faire face, dans un couple, ce n’est pas toujours sauver la relation. C’est parfois se sauver soi.
Avec les enfants
Un enfant détecte l’injustice comme un chien sent l’orage. Pas besoin d’explications, il sait. Le frère qu’on félicite, la sœur qu’on gâte, et lui qui attend. L’effort qu’on balaie d’un « tu pouvais mieux faire ». La punition tombée sans écoute. Les comparaisons venimeuses : « Regarde ton frère, lui au moins… »
Ces petites morsures s’impriment. Beaucoup d’adultes portent encore la trace de ces injustices : l’anniversaire oublié, le jouet offert à l’autre, la punition injuste. Ce n’est pas seulement un souvenir, c’est une cicatrice encore vive. Et l’adulte qu’on devient se surprend à chercher sans cesse la reconnaissance qu’on n’a pas reçue.
L’enfant blessé continue de chuchoter : « Tu ne vaux pas assez. » Et tant qu’on ne l’écoute pas, il prend toute la place.
Comment faire face ?
En reconnaissant la douleur : « Oui, j’ai souffert de favoritisme. Oui, j’ai ressenti une injustice. » Ce n’est pas accuser, c’est honorer l’enfant que l’on a été.
En se donnant aujourd’hui ce qui manqua hier : se féliciter, se parler avec bienveillance, se traiter avec respect.
Et, si l’on est parent, en brisant le cercle : offrir à chaque enfant non pas la même chose, mais ce dont il a besoin.
Parce qu’au fond, l’équité, ce n’est pas couper le gâteau en parts égales : c’est s’assurer que chacun ait assez pour être rassasié.
À l’école
L’école devrait être un lieu d’équité. En réalité, elle distribue les rôles comme une mauvaise pièce de théâtre. L’élève brillant reçoit les louanges, l’enfant discret devient invisible. Le harcelé est accusé d’exagérer. Le rêveur est traité de paresseux. L’artiste est relégué, parce que son talent ne rentre pas dans les cases.
Ces injustices scolaires ne disparaissent pas avec le diplôme. Elles s’accrochent à la peau. L’adulte garde cette impression : « Je ne suis pas assez », « Je ne compte pas ». Et les fantômes de la salle de classe reviennent dans chaque échec, chaque doute, chaque peur de prendre la parole.
Comment faire face ?
En revisitant ce passé avec un regard adulte : ces notes n’étaient pas des sentences, mais des chiffres.
En rouvrant les portes fermées : reprendre la guitare, le dessin, le sport laissé de côté, donner enfin justice à l’enfant étouffé.
En offrant aux enfants d’aujourd’hui un regard différent : féliciter les efforts, pas seulement les résultats.
Car la vraie école n’est pas celle des bulletins. C’est celle qui apprend à chacun qu’il a une valeur. Même si personne ne l’avait dit à l’époque.
Au travail
Le travail est une usine à fabriquer de l’injustice en série. Celui qui s’épuise reste invisible, celui qui papillonne récolte une promotion. Les règles sont de fer pour certains, souples pour d’autres. Et quand vient le licenciement, il tombe souvent sur le plus loyal. On se dit parfois que Kafka a dû être nommé directeur des ressources humaines.
Cette injustice ronge. Elle attaque l’estime de soi, éteint la motivation, rend chaque lundi plus lourd que le précédent. Et on se rappelle ce slogan : « Le travail, c’est la santé. » Oui, sans doute… mais surtout celle du médecin du travail, dont la salle d’attente déborde.
Et pourtant, beaucoup restent dans des lieux toxiques. Pourquoi ? Pour l’argent. Comme si un virement bancaire pouvait racheter des nuits blanches, des ulcères ou des burn-out. On oublie trop souvent que la santé n’a pas de prix, et que l’argent, lui, se retrouve ailleurs. Rester « pour le salaire », c’est vendre son souffle contre un chèque, en espérant que la paye compense l’air qu’on perd. Mais un compte en banque bien garni n’a jamais guéri une dépression.
Comment faire face ?
En distinguant ce qui dépend de soi de ce qui échappe.
En posant ses limites quand on se sent exploité : dire non, rappeler qu’on n’est pas une photocopieuse qu’on fait tourner jusqu’à surchauffe.
En cherchant de la reconnaissance ailleurs : dans une passion, un projet, un cercle d’amis.
Et parfois, en ayant le courage de quitter un lieu toxique, même si le salaire semblait un filet de sécurité. Car rester pour l’argent, c’est oublier que sa santé, elle, ne se retrouve nulle part une fois perdue.
Le travail devrait nourrir. Quand il dévore, il faut savoir lui retirer son assiette.
Dans l’amitié
On imagine l’amitié pure, gratuite, au-dessus des calculs. Pourtant, qui n’a jamais ressenti l’injustice d’être toujours celui qui écoute, mais qu’on n’écoute jamais ? Toujours présent dans les malheurs, mais absent des joies. Sollicité pour déménager des cartons, mais oublié quand il s’agit d’ouvrir une bouteille.
Et puis il y a l’injustice plus sournoise : celle de la confiance trahie. On se livre, on raconte ses blessures, et l’autre, un jour, les sert en amuse-gueule à d’autres oreilles. Ce qu’on avait confié comme un secret devient une anecdote pour briller dans une soirée. C’est l’impression d’avoir tendu son cœur, et de le voir étalé en place publique.
L’injustice en amitié n’est pas toujours un coup de couteau. Parfois, c’est pire : c’est une confidence détournée, un silence calculé, une loyauté manquante.
Comment faire face ?
En voyant le déséquilibre pour ce qu’il est.
En osant mettre de la distance, même si cela bouleverse.
En faisant de la place à d’autres liens, plus vrais, plus nourrissants.
Un ami véritable n’est pas celui qui connaît vos failles pour les répéter, mais celui qui les garde comme un trésor qu’il protège.
Dans les familles
Les familles, censées être des refuges, sont parfois des théâtres de cruauté. Le favoritisme parental, les comparaisons venimeuses, les héritages qui réveillent toutes les rancunes. L’un a eu le vélo neuf, l’autre la carcasse rouillée. L’un était le « chouchou », l’autre celui qui devait ramer. Et trente ans plus tard, autour d’un testament, les blessures resurgissent comme si elles n’avaient jamais cicatrisé.
À cela s’ajoute la question des « pièces rapportées » : les conjoints, belles-filles, beaux-frères… Ceux qu’on regarde parfois comme des intrus, des profiteurs, ou au contraire comme des perturbateurs venus « voler » l’amour d’un fils, l’attention d’une mère, la place d’un frère. L’injustice ici, c’est d’être jugé non pas pour qui l’on est, mais pour le simple fait de ne pas appartenir au sang. Et combien de repas de famille se transforment en tribunaux improvisés, où l’on scrute chaque mot, chaque geste du « rapporté » pour mieux l’accuser.
Ces injustices sont terribles, car on ne peut pas démissionner de sa famille comme on quitte une entreprise. Alors on rumine, on compte les humiliations, on refait le procès de son enfance… ou de son mariage. L’amour semblait distribué comme des parts de gâteau… sauf que certains avaient toujours la plus grosse part, et d’autres n’avaient même pas de part du tout, juste les miettes tombées à côté de l’assiette.
Comment faire face ?
En nommant ce ressenti : dire « J’ai souffert de ce favoritisme » ou « Je n’ai jamais été accepté » est déjà une libération.
En acceptant que certaines blessures resteront ouvertes : vouloir que tout s’arrange est parfois un mirage.
En choisissant de protéger sa paix intérieure, parfois par la distance.
Et en se construisant une famille de cœur : ces liens choisis, qui offrent ce que le sang n’a pas donné.
Après tout, mieux vaut un ami fidèle qu’un beau-frère qui vous salue d’un sourire avant de vous poignarder pour un bout de terrain.
Face à la vie
Et puis, il y a l’injustice ultime. Celle qui dépasse tout. La maladie qui frappe au hasard. L’accident qui arrache un proche. L’enfant qui part avant ses parents. Ici, ce n’est pas seulement un sentiment d’injustice : c’est l’injustice absolue, celle qui ne laisse aucune explication. On voudrait demander des comptes, mais à qui ? À la nature ? Mais la nature ne connaît pas la justice. Elle est amorale, indifférente. Le vent souffle, la pluie tombe, la foudre frappe : ce n’est ni châtiment ni récompense. C’est aussi indifférent que la gravité qui vous rappelle au sol quand vous tombez. La nature ne punit pas, elle s’en fiche.
Comment faire face ?
Pas de clé magique. Mais parfois, parler aide. Mettre des mots sur l’indicible, partager avec ceux qui comprennent.
Tendre la main à d’autres, transformer la douleur en solidarité.
Et parfois, simplement tenir, un jour après l’autre, jusqu’à ce que la brûlure s’apaise un peu.
Ces injustices ne guérissent pas. Mais elles peuvent, parfois, ouvrir une humanité nouvelle : plus lucide, plus humble, plus attentive à la fragilité des vies.
Conclusion
Le sentiment d’injustice nous traverse tous. Dans le couple, avec les enfants, à l’école, au travail, dans l’amitié, dans la famille, face à la vie. Il brûle, il ronge, il détruit. Mais il peut aussi réveiller. Faire face, ce n’est pas l’effacer. C’est mettre des mots, poser des limites, chercher ailleurs ce qui manque, inventer un sens quand tout semble perdu.
L’injustice nous met à genoux. Mais c’est aussi elle qui, parfois, nous pousse à nous relever.